De nombreux écrivains, artistes francophones, de grand talent, sont souvent, hélas, méconnus au sein de la Francophonie.
Le Centre Francophonie de Bourgogne a eu le bonheur d’en recevoir un certain nombre. Mais beaucoup d’autres méritent amplement notre attention. Francine ALLARD, est de ceux-là. C’est un honneur pour nous de lui donner la parole dans notre rubrique " Les artistes francophones ont du talent ".
Le Centre Francophonie de Bourgogne a eu le bonheur d’en recevoir un certain nombre. Mais beaucoup d’autres méritent amplement notre attention. Francine ALLARD, est de ceux-là. C’est un honneur pour nous de lui donner la parole dans notre rubrique " Les artistes francophones ont du talent ".

Cinq questions à Francine ALLARD, écrivain, poète et artiste québécoise.
1) Francine Allard, vous êtes québécoise, et le Québec a joué un rôle actif dans la constitution de l’espace francophone, qu’attendez-vous personnellement de la Francophonie ?
En 2008, j’ai participé à la XVIIème Conférence internationale des peuples de langue française qui se tenait au Québec. Je suis membre de l’Association des Écrivains francophones d’Amérique, c’est dire que la Francophonie revêt une importance majeure pour moi. Et j’ajoute qu’elle se doit d’être omniprésente pour tous les écrivains québécois puisque notre province est secouée, comme vous le savez, par des considérations politiques, étant un petit bateau francophone naviguant par vents et marées sur une mer anglophone.
En 2008, j’ai participé à la XVIIème Conférence internationale des peuples de langue française qui se tenait au Québec. Je suis membre de l’Association des Écrivains francophones d’Amérique, c’est dire que la Francophonie revêt une importance majeure pour moi. Et j’ajoute qu’elle se doit d’être omniprésente pour tous les écrivains québécois puisque notre province est secouée, comme vous le savez, par des considérations politiques, étant un petit bateau francophone naviguant par vents et marées sur une mer anglophone.
Le français est en péril chez nous et l’écrivain — celui qui porte les mots — doit exercer une influence plus grande que dans n’importe quel pays francophone. Je porte ce désir d’un pays indépendant comme une mère aimante désire l’affranchissement de son enfant. Je collabore également au bulletin de l’Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française (ASSELAF) qui siège à Paris, représentant le point de vue d’une écrivaine québécoise.
Au Québec, diverses littératures francophones se fréquentent et viennent titiller nos racines multiples et notre esprit humaniste. Les écrivains de toutes origines reçoivent au Canada francophone un accueil exemplaire.
En tant qu’écrivaine à multiples facettes, je suis la première à profiter de l’influence généreuse des créateurs du monde. Mes romans pour les jeunes ont mené mes petits lecteurs en Écosse, au Mexique, en Afrique, même si je n’y suis jamais allée. Une collection de guides Michelin et du Petit routard ornent ma bibliothèque personnelle et m’aident à rendre les voyages très proches de la réalité. Comme si on y était ! Mes romans d’époque, dans le Québec montréalais et campagnard, La Couturière, démontrent ce que le français a fait de mieux pour l’intrusion du Québec au monde francophone international. La contribution de ma littérature à ce fait sociopolitique mondial est désormais incontestable et je m’en réjouis. Faire partie de la littérature francophone internationale est le plus grand bien que je me souhaite pour 2010.
2) Dans vos œuvres, vous abordez des sujets peu traités en littérature : la psychiatrie, l’enfance handicapée, est-ce par formation, par compassion ou par humanité?
Je n’écris pas de la littérature jeunesse pour uniquement amuser les enfants. Comme la plupart des romans pour les jeunes sont écrits par des «vieux», je suis toujours étonnée de constater que beaucoup d’auteurs d’ici passent outre la qualité de la langue pour faciliter la compréhension des jeunes. Pour qu’ils ne se sentent pas seuls au centre de leurs imbroglios, ces auteurs tentent, par la complaisance, de nouer des liens avec leurs lecteurs. L’auteur parle comme eux, les place dans un monde familier, leur présente des situations qu’ils connaissent, sans jamais les mener plus loin ni leur demander l’effort nécessaire pour avancer. Il y a maintenant une littérature pour l’enfant devenu roi. Je tente de m’en dissocier.
Me voici donc avec des romans littéraires (déjà une différence) qui parlent aux enfants des vieillards, de la consécration de l’enfance, si je puis dire, mais aussi du respect de l’adulte. Dans mes romans, les enfants n’ont pas toujours raison et ils sont placés devant leur propre miroir et doivent apprendre à juger leurs actions. Je leur parle aussi des enfants handicapés intellectuels (Deux petits ours au milieu de la tornade – éd. Vents d’Ouest ; La dernière course de Mado Bélanger - éd. Québec-Amérique) ; de la différence (Une fleur entre deux pierres – éd. Marcel Broquet ; L’Univers secret de Willie Flibot – HMH Hurtubise) sans négliger toutes mes collaborations à des collectifs dans lesquelles je traite d’Alzheimer ou de cancer infantile. J’ai aussi écrit des romans fantastiques qui ne visaient que la détente.
des vieillards, de la consécration de l’enfance, si je puis dire, mais aussi du respect de l’adulte. Dans mes romans, les enfants n’ont pas toujours raison et ils sont placés devant leur propre miroir et doivent apprendre à juger leurs actions. Je leur parle aussi des enfants handicapés intellectuels (Deux petits ours au milieu de la tornade – éd. Vents d’Ouest ; La dernière course de Mado Bélanger - éd. Québec-Amérique) ; de la différence (Une fleur entre deux pierres – éd. Marcel Broquet ; L’Univers secret de Willie Flibot – HMH Hurtubise) sans négliger toutes mes collaborations à des collectifs dans lesquelles je traite d’Alzheimer ou de cancer infantile. J’ai aussi écrit des romans fantastiques qui ne visaient que la détente.
J’ai une formation d’enseignante auprès d’enfants inadaptés que j’ai toujours appelés «mes petites fleurs malades». Je n’ai enseigné que quelques années, mais j’ai toujours été préoccupée par les personnes dissemblables. À la sortie de mon roman Deux petits ours au milieu de la tornade, cinq journalistes m’ont parlé du début du chapitre douze qui les a marqués puisque Bertrand, le personnage principal, explique à sa mère comment se sent un enfant handicapé mentalement. C’est un passage très touchant comme si j’avais été capable d’entrer dans la tête d’un jeune handicapé intellectuel. J’ai toujours été touchée par la différence. Je me suis toujours impliquée avec ma plume, comme arme défensive plus qu’offensive, pour la protection des gens mis sur la voie d’accotement : les enfants malades ou abusés, les vieillards abandonnés, les victimes innocentes. Je le fais avec toute la poésie qui caractérise mon écriture.
Au Québec, diverses littératures francophones se fréquentent et viennent titiller nos racines multiples et notre esprit humaniste. Les écrivains de toutes origines reçoivent au Canada francophone un accueil exemplaire.
En tant qu’écrivaine à multiples facettes, je suis la première à profiter de l’influence généreuse des créateurs du monde. Mes romans pour les jeunes ont mené mes petits lecteurs en Écosse, au Mexique, en Afrique, même si je n’y suis jamais allée. Une collection de guides Michelin et du Petit routard ornent ma bibliothèque personnelle et m’aident à rendre les voyages très proches de la réalité. Comme si on y était ! Mes romans d’époque, dans le Québec montréalais et campagnard, La Couturière, démontrent ce que le français a fait de mieux pour l’intrusion du Québec au monde francophone international. La contribution de ma littérature à ce fait sociopolitique mondial est désormais incontestable et je m’en réjouis. Faire partie de la littérature francophone internationale est le plus grand bien que je me souhaite pour 2010.
2) Dans vos œuvres, vous abordez des sujets peu traités en littérature : la psychiatrie, l’enfance handicapée, est-ce par formation, par compassion ou par humanité?
Je n’écris pas de la littérature jeunesse pour uniquement amuser les enfants. Comme la plupart des romans pour les jeunes sont écrits par des «vieux», je suis toujours étonnée de constater que beaucoup d’auteurs d’ici passent outre la qualité de la langue pour faciliter la compréhension des jeunes. Pour qu’ils ne se sentent pas seuls au centre de leurs imbroglios, ces auteurs tentent, par la complaisance, de nouer des liens avec leurs lecteurs. L’auteur parle comme eux, les place dans un monde familier, leur présente des situations qu’ils connaissent, sans jamais les mener plus loin ni leur demander l’effort nécessaire pour avancer. Il y a maintenant une littérature pour l’enfant devenu roi. Je tente de m’en dissocier.
Me voici donc avec des romans littéraires (déjà une différence) qui parlent aux enfants
 des vieillards, de la consécration de l’enfance, si je puis dire, mais aussi du respect de l’adulte. Dans mes romans, les enfants n’ont pas toujours raison et ils sont placés devant leur propre miroir et doivent apprendre à juger leurs actions. Je leur parle aussi des enfants handicapés intellectuels (Deux petits ours au milieu de la tornade – éd. Vents d’Ouest ; La dernière course de Mado Bélanger - éd. Québec-Amérique) ; de la différence (Une fleur entre deux pierres – éd. Marcel Broquet ; L’Univers secret de Willie Flibot – HMH Hurtubise) sans négliger toutes mes collaborations à des collectifs dans lesquelles je traite d’Alzheimer ou de cancer infantile. J’ai aussi écrit des romans fantastiques qui ne visaient que la détente.
des vieillards, de la consécration de l’enfance, si je puis dire, mais aussi du respect de l’adulte. Dans mes romans, les enfants n’ont pas toujours raison et ils sont placés devant leur propre miroir et doivent apprendre à juger leurs actions. Je leur parle aussi des enfants handicapés intellectuels (Deux petits ours au milieu de la tornade – éd. Vents d’Ouest ; La dernière course de Mado Bélanger - éd. Québec-Amérique) ; de la différence (Une fleur entre deux pierres – éd. Marcel Broquet ; L’Univers secret de Willie Flibot – HMH Hurtubise) sans négliger toutes mes collaborations à des collectifs dans lesquelles je traite d’Alzheimer ou de cancer infantile. J’ai aussi écrit des romans fantastiques qui ne visaient que la détente.J’ai une formation d’enseignante auprès d’enfants inadaptés que j’ai toujours appelés «mes petites fleurs malades». Je n’ai enseigné que quelques années, mais j’ai toujours été préoccupée par les personnes dissemblables. À la sortie de mon roman Deux petits ours au milieu de la tornade, cinq journalistes m’ont parlé du début du chapitre douze qui les a marqués puisque Bertrand, le personnage principal, explique à sa mère comment se sent un enfant handicapé mentalement. C’est un passage très touchant comme si j’avais été capable d’entrer dans la tête d’un jeune handicapé intellectuel. J’ai toujours été touchée par la différence. Je me suis toujours impliquée avec ma plume, comme arme défensive plus qu’offensive, pour la protection des gens mis sur la voie d’accotement : les enfants malades ou abusés, les vieillards abandonnés, les victimes innocentes. Je le fais avec toute la poésie qui caractérise mon écriture.


 Je pense que c’est le plus bel héritage que j’aurai laissé à plusieurs générations de jeunes lecteurs.
Je pense que c’est le plus bel héritage que j’aurai laissé à plusieurs générations de jeunes lecteurs.3) Vous êtes romancière, poète, vous avez fait le conservatoire de musique et d’art dramatique, vous avez enseigné, vous avez été choriste à Radio Canada, un temps humoriste, vous êtes aquarelliste, faites de la poterie, vous montez des spectacles, intervenez sur des sujets d’actualité avec passion et sans concession, qu’est-ce qui motive une telle activité débordante ?
Une activité bourdonnante vient d’une imagination débordante. Je suis de ceux qui sont nés avec le début de la culture québécoise au Canada. Ma mère m’a alors inscrite à des leçons de ballet, de piano, d’arts plastiques, de danse folklorique, de peinture et j’en oublie sûrement. Très encouragée par mes parents, j’ai été admise au Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec en chant classique, puis j’ai pu compléter parallèlement le lycée (cours classique) jusqu’à l’université en philosophie. C’est paradoxalement en côtoyant Søren Kierkegaard, Platon, Martin Heidegger, et Nietzsche que j’ai compris que je devais choisir une profession humaniste. Leurs contradictions étaient les miennes et j’ai été convaincue de devenir enseignante pour éduquer les adultes de demain.
J’étais née enseignante. Je le suis toujours demeurée. Ainsi, placée devant un groupe quel qu’il soit, je me transforme en transmetteur de quelque chose. Je dis de la poésie devant des salles combles, je donne des conférences sur les sujets les plus inquiétants et me voilà dans mon élément. Celui du croisement des regards, des signes approbateurs, des rires surtout. Comme j’ai étudié l’art de la scène, le théâtre et le chant, et que j’ai fait mes premières armes comme humoriste, je suis très à l’aise devant un public. Où je suis totalement déstabilisée, c’est quand je doute que l’auditoire me comprenne. Mon premier voyage à Nice en 2004 m’a fait comprendre que je devais quitter mon accent québécois, même si mon amoureux se moquait de mon accent du sud ! Je souffre de mimétisme aigu. Vous auriez dû m’entendre discuter avec des Marseillais et leur «assent». C’est pareil quand je vais en Acadie, au Nouveau-Brunswick. J’attrape l’accent.
J’ai besoin de m’exprimer mais aussi, de m’assurer la vie éternelle puisque celle que me promettait l’Église Catholique de jadis, est disparue en même temps que ma ferveur. Je tente par tous les moyens de laisser des traces : la dentelle, l’aquarelle, la poterie, l’écriture sont des moyens que je privilégie. Montrer ce que je suis par les choses que je fais ! Nous avons bâti un atelier d’artiste à cinquante mètres de notre maison qui s’appelle l’ANTRE de Ferron (Jacques Ferron étant un grand écrivain québécois et médecin comme mon conjoint) où j’ai installé une galerie d’art et de poésie. Les touristes qui y entrent se voient offrir un thé japonais (en l’honneur de Dany Laferrière) et peuvent entendre de la poésie, la mienne. Je vis pour la création. Et je souffre aussi pour elle.
4) Votre trilogie « La couturière » est prodigieuse, et nous l’espérons, vouée à un grand avenir, pourquoi vous êtes-vous lancée dans une saga si grandiose et qu’est-ce que vos recherches vous ont appris sur le Québec?


La Couturière (Les aiguilles du temps et La vengeance de la veuve noire) est une saga de près de 1 500 pages, publiée chez le grand Victor-Lévy Beaulieu, sans doute notre Victor Hugo à nous. J’en suis très fière. Mais que les Français puissent lire et aimer cette trilogie (La persistance du romarin, troisième tome en gestation) me comblerait de bonheur. Oui, je plonge dans le quotidien de la campagne québécoise avec le personnage de Donatienne Crevier, devenue soignante par les plantes, et Montréal, la citadine, avec le personnage d’Émilia Trudel, devenue créatrice de mode comme le fut Christian Dior.
J’ai besoin de m’exprimer mais aussi, de m’assurer la vie éternelle puisque celle que me promettait l’Église Catholique de jadis, est disparue en même temps que ma ferveur. Je tente par tous les moyens de laisser des traces : la dentelle, l’aquarelle, la poterie, l’écriture sont des moyens que je privilégie. Montrer ce que je suis par les choses que je fais ! Nous avons bâti un atelier d’artiste à cinquante mètres de notre maison qui s’appelle l’ANTRE de Ferron (Jacques Ferron étant un grand écrivain québécois et médecin comme mon conjoint) où j’ai installé une galerie d’art et de poésie. Les touristes qui y entrent se voient offrir un thé japonais (en l’honneur de Dany Laferrière) et peuvent entendre de la poésie, la mienne. Je vis pour la création. Et je souffre aussi pour elle.
4) Votre trilogie « La couturière » est prodigieuse, et nous l’espérons, vouée à un grand avenir, pourquoi vous êtes-vous lancée dans une saga si grandiose et qu’est-ce que vos recherches vous ont appris sur le Québec?


La Couturière (Les aiguilles du temps et La vengeance de la veuve noire) est une saga de près de 1 500 pages, publiée chez le grand Victor-Lévy Beaulieu, sans doute notre Victor Hugo à nous. J’en suis très fière. Mais que les Français puissent lire et aimer cette trilogie (La persistance du romarin, troisième tome en gestation) me comblerait de bonheur. Oui, je plonge dans le quotidien de la campagne québécoise avec le personnage de Donatienne Crevier, devenue soignante par les plantes, et Montréal, la citadine, avec le personnage d’Émilia Trudel, devenue créatrice de mode comme le fut Christian Dior.
Quand un francophone d’ailleurs lit La Couturière, il apprend tout sur le Québec, de la vie des gens en 1910 jusqu’à l’arrivée de l’Exposition universelle de 1967. Cette année-là a fait pénétrer le Québec dans la cour des grands et grâce à Jean Drapeau, le maire visionnaire de Montréal, le monde a commencé à nous entendre. À l’instar de Félix Leclerc, sont arrivés en Europe de nombreux écrivains, des chanteurs, des gens de théâtre et de cirque et des humoristes. Bien qu’il y ait encore beaucoup à accomplir pour faire connaître notre littérature en France — comme votre organisme le fait à merveille —les écrivains québécois sont en de meilleures postures qu’avant.
Je ne peux pas affirmer avoir beaucoup appris par mes nombreuses recherches sur le Québec du début du XXème siècle. Les femmes de ma vie, mes grands-mères et ma mère m’en ont tant parlé. Mais j’ai appris sur la psychologie des gens dont les enfants allaient au front pour une monarchie qui était une légende. La Grande Bretagne a donné, il y a longtemps, une petite tape sur le derrière du Canada en lui offrant aussi sa liberté. Le Québec seul a compris cela comme l’enfant le plus déluré des dix. J’ai appris cependant une chose primordiale : quand un écrivain raconte le passé, il faut qu’il sache tout, dans les moindres détails au sujet de ce passé.
Je ne peux pas affirmer avoir beaucoup appris par mes nombreuses recherches sur le Québec du début du XXème siècle. Les femmes de ma vie, mes grands-mères et ma mère m’en ont tant parlé. Mais j’ai appris sur la psychologie des gens dont les enfants allaient au front pour une monarchie qui était une légende. La Grande Bretagne a donné, il y a longtemps, une petite tape sur le derrière du Canada en lui offrant aussi sa liberté. Le Québec seul a compris cela comme l’enfant le plus déluré des dix. J’ai appris cependant une chose primordiale : quand un écrivain raconte le passé, il faut qu’il sache tout, dans les moindres détails au sujet de ce passé.
C’est ce que je crois avoir réalisé en écrivant La Couturière. Le troisième tome sera accompagné d’une longue bibliographie qui attestera des nombreux manuels historiques que j’ai consultés. Mes lecteurs pourront poursuivre leur incursion dans cet univers qui a servi le mien. Je refuse cependant d’y inclure un glossaire des termes québécois. Parce que lorsque j’ai entendu Fernandel qui disait par exemple Le Curé de Cucugnan, ou quand j’ai lu Pagnol ou tous les auteurs contemporains qui utilisent l’argot parisien, j’ai simplement appris par le contexte et je veux que mes lecteurs français s’amusent aussi. Quoique la langue de La Couturière soit presque exempte de québécismes.
J’ai appris, parmi la horde immense de romans d’époque qui peuplent les librairies en ce moment, qu’il faut décupler les efforts de promotion. Le roman Les Filles de Caleb, par exemple, est arrivé à point nommé et s’est vendu à des milliers d’exemplaires. Au Québec, vu le petit nombre de lecteurs, on a un best-seller quand on vend 3 000 copies d’un roman. La Couturière a dépassé le cap des 10 000 exemplaires.
5) Vos aquarelles sont très frappantes : les couleurs, le montage, la recherche, pourquoi est-ce cet art que vous privilégiez ?
L’aquarelle a presque toujours servi, par sa transparence, à dessiner des paysages, des fleurs ou des poissons. C’est ce que l’école d’aquarelle m’a appris. Des nœuds sur les troncs d’arbres, des brins d’herbe sortant de la neige, des jardins fleuris. Ma première aquarelle représentait une grosse femme tenant une glace derrière laquelle se tenait un jeune enfant, la salive à la bouche. Il y avait plein de couleurs estompées au papier mouchoir. Je lui ai posé un passe-partout et je l’ai apportée à mon professeur. Elle avait beaucoup à critiquer en tant que technicienne, mais avouait qu’elle était subjuguée. La semaine suivante, l’éditeur Alain Stanké se servait de La grosse dame au cornet pour la couverture de mon premier roman : Ma belle pitoune en or (1995).
J’aime la folie que me permettent les arts visuels. Le pastel gras ou sec, l’acrylique, le papier fait main, les masques de semi-porcelaine sous vitrine, me permettent de m’exprimer, mais jamais comme l’aquarelle qui demande un vaste geste spontané —on ne retouche pas l’aquarelle — et se prête bien à la gestuelle contemporaine. Ainsi, en ce moment, je travaille à une collection intitulée VINO dans laquelle j’utilise d’abord la calligraphie à la plume pour inscrire des centaines de noms de vins français ou italiens (mon amoureux est un oenophile consacré) que je noie dans l’aquarelle puis j’ajoute des étiquettes et même des capsules de bouteilles en plomb que je transforme en sesterces. Le résultat est très apprécié.
J’ai appris, parmi la horde immense de romans d’époque qui peuplent les librairies en ce moment, qu’il faut décupler les efforts de promotion. Le roman Les Filles de Caleb, par exemple, est arrivé à point nommé et s’est vendu à des milliers d’exemplaires. Au Québec, vu le petit nombre de lecteurs, on a un best-seller quand on vend 3 000 copies d’un roman. La Couturière a dépassé le cap des 10 000 exemplaires.
5) Vos aquarelles sont très frappantes : les couleurs, le montage, la recherche, pourquoi est-ce cet art que vous privilégiez ?
L’aquarelle a presque toujours servi, par sa transparence, à dessiner des paysages, des fleurs ou des poissons. C’est ce que l’école d’aquarelle m’a appris. Des nœuds sur les troncs d’arbres, des brins d’herbe sortant de la neige, des jardins fleuris. Ma première aquarelle représentait une grosse femme tenant une glace derrière laquelle se tenait un jeune enfant, la salive à la bouche. Il y avait plein de couleurs estompées au papier mouchoir. Je lui ai posé un passe-partout et je l’ai apportée à mon professeur. Elle avait beaucoup à critiquer en tant que technicienne, mais avouait qu’elle était subjuguée. La semaine suivante, l’éditeur Alain Stanké se servait de La grosse dame au cornet pour la couverture de mon premier roman : Ma belle pitoune en or (1995).
J’aime la folie que me permettent les arts visuels. Le pastel gras ou sec, l’acrylique, le papier fait main, les masques de semi-porcelaine sous vitrine, me permettent de m’exprimer, mais jamais comme l’aquarelle qui demande un vaste geste spontané —on ne retouche pas l’aquarelle — et se prête bien à la gestuelle contemporaine. Ainsi, en ce moment, je travaille à une collection intitulée VINO dans laquelle j’utilise d’abord la calligraphie à la plume pour inscrire des centaines de noms de vins français ou italiens (mon amoureux est un oenophile consacré) que je noie dans l’aquarelle puis j’ajoute des étiquettes et même des capsules de bouteilles en plomb que je transforme en sesterces. Le résultat est très apprécié.
Je tente de vendre à des vignerons québécois des œuvres qui nomment leurs produits portant de jolies appellations. Ce n’est pas si différent de l’écriture. Et je peux écrire en picolant un peu, non ? Vous pouvez visiter ma galerie en allant sur mon site :
Vous pouvez visiter ma galerie en allant sur mon site :
http://www.francineallard.com/
 Vous pouvez visiter ma galerie en allant sur mon site :
Vous pouvez visiter ma galerie en allant sur mon site :http://www.francineallard.com/










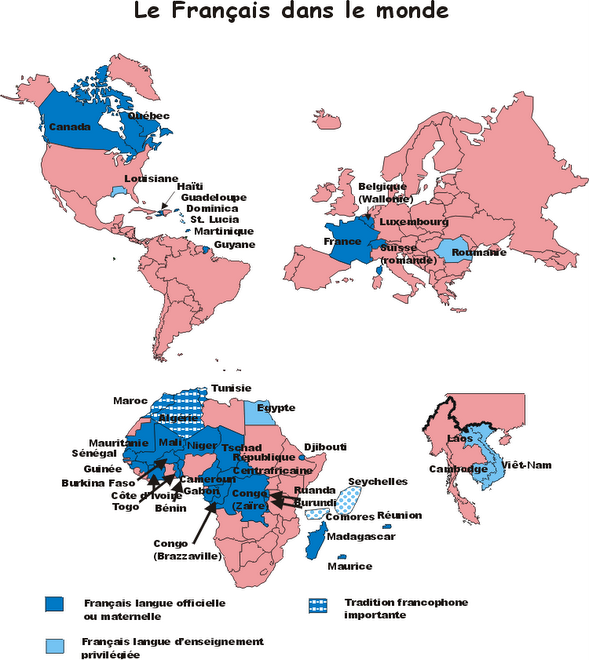
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire